 Étude de Matthieu 7,24-27 : les deux maisons. Voici une parabole que l’on raconte volontiers aux enfants… et si les adultes l’étudiaient… qu’en feraient-ils ?
Étude de Matthieu 7,24-27 : les deux maisons. Voici une parabole que l’on raconte volontiers aux enfants… et si les adultes l’étudiaient… qu’en feraient-ils ?
Introduction à l’Evangile selon Matthieu – sa place dans la Bible. Un des livres du Nouveau Testament
Le Nouveau Testament (NT) comprend 27 livres de longueurs variables, tous écrits en grec par divers auteurs à des dates différentes au cours du 1er siècle. Ils ont été transmis par d’innombrables manuscrits, le plus ancien est daté de l’an 135. Les livres sont rangés par leur genre littéraire : évangiles, actes, lettres, apocalypse et par leur longueur. Chaque livre est divisé en chapitres, selon la division proposée par Etienne Langton et attestée en 1226. Les chapitres ont été eux-mêmes divisés en versets par Robert Estienne, au cours d’un voyage en diligence en 1551 [1]. Ces précisions sont importantes : elles obligent tout lecteur du Nouveau Testament à lire de manière critique les extraits bibliques, à vérifier le début et la fin de chaque « histoire » et à prendre en considération ce qui précède, ce qui suit et même tout le livre. Le livre de Matthieu est composé de 28 chapitres et de 1 068 versets (il a presque la même taille que l’évangile de Luc).
Matthieu, le premier évangile
Le mot français « évangile » est directement dérivé du grec « euaggelion » qui désignait primitivement la récompense que l’on accordait à un messager pour la transmission d’une bonne nouvelle. Par extension, ce terme désigna la bonne nouvelle elle-même [2]. Cette Bonne Nouvelle concerne Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, le Messie. L’auteur de l’évangile de Matthieu respecte profondément le livre et l’autorité de Marc, qu’il recopie. Il a conservé 606 des 661 versets de Marc, bien qu’il abrège presque chaque épisode de Marc (de 20 à 30 % en moyenne). Mais en bon scribe, il traduit et interprète. Plus exactement, il réécrit l’évangile de Marc pour donner un sens nouveau à son texte [3]. Il a 330 versets que l’on ne retrouve ni chez Marc, ni chez Luc [4]. En évangéliste, Matthieu rapporte, à sa manière propre, la vie et l’enseignement de Jésus [5], le Christ. L’intention de l’œuvre est donnée dès le début du livre : son nom sera Emmanuel, « Dieu avec nous » et il va « être avec » les disciples jusqu’à la fin des temps [6].
Un plan de livre difficile à établir
Les spécialistes discutent la question de la composition du livre de Matthieu. Trois plans différents se dégagent aujourd’hui.
Le plan géographique permet de situer le ministère de Jésus en Galilée (4,12 à 13,58), puis dans les régions limitrophes et en route vers Jérusalem (chapitres 14 à 20) et enfin à Jérusalem même (chapitres 21 à 28). Nul n’a pu montrer l’intention théologique d’une telle répartition qui a le mérite de donner un cadre géographique [7].
Le plan didactique met en évidence les cinq « discours » de Jésus, chacun se rapportant à un thème précis. Ils se terminent tous par la formule « Or, quand Jésus eut achevé ces instructions… » De fait, on distingue cinq blocs : les chapitres 5 à 7 ; 10 ; 13 ; 18 et 24-25. Chaque discours est précédé d’une section narrative plus ou moins longue. Les récits de l’enfance inaugurent le livre de Matthieu et les récits de la Passion et de la Résurrection de Jésus terminent le livre [8].
Le plan en deux parties. Dans la première (chapitres 3 à 13), Jésus se présente à son peuple, mais celui-ci refuse de croire en lui. Tout puissant en œuvres et en paroles, Jésus envoie ses disciples annoncer la Bonne Nouvelle ; les auditeurs sont confrontés à l’option pour ou contre lui. Dans la deuxième partie (chapitres 14 à 28), Jésus parcourt le chemin qui le mène à Jérusalem, de la croix à la Résurrection [9].
Histoire du livre de Matthieu
Si Matthieu 22,7 fait allusion à la destruction du Temple et de Jérusalem, alors la rédaction de l’évangile selon Matthieu peut être située après les années 70 de notre ère. Les spécialistes s’accordent pour situer la rédaction du livre de Matthieu vers les années 80-90 [10].
Qui est Matthieu ? Qualités littéraires
Matthieu insiste sur les Écritures juives qu’il connaît, sur la Loi et les coutumes juives qu’il n’explique pas : ses auditeurs ou lecteurs doivent donc comprendre le sujet du débat, étant du même milieu que lui. Il insiste sur l’accomplissement de l’Écriture en la personne de Jésus. Le Christ est présenté comme le Messie promis, mais aussi comme le Maître par excellence, enseignant une nouvelle justice, une nouvelle fidélité à la loi de Dieu [11]. Il ne s’agit pas d’être un « nouvel Israël » mais « LE véritable Israël » [12]. La différence est importante, car la nouveauté religieuse était assimilée à une secte alors qu’en affirmant que Jésus accomplit la tradition juive, Matthieu proclame Jésus comme le Messie attendu – et non reconnu – par Israël. Le livre de Matthieu montre l’accomplissement par Jésus des prophéties faites à Israël.
Sa théologie
(en lien avec l’histoire des deux maisons) : pour l’auteur de l’évangile, Jésus est le Messie. Il propose une nouvelle Alliance, qui est ouverte à tous. Il s’agit maintenant de faire le bon choix.
D’après la tradition historique
La plus ancienne tradition ecclésiale (Papias, avant l’an 150) identifie l’auteur avec l’apôtre Matthieu-Lévi, ainsi que le feront de nombreux Pères de l’Eglise (Origène, Jérôme…). A travers son œuvre, l’auteur se révèle être un lettré juif, devenu chrétien, versé dans les Écritures et passé maître dans l’art de présenter Jésus, insistant toujours sur les conséquences pratiques de son enseignement. Le texte est pétri de traditions juives et utilise un vocabulaire palestinien [13].
Aujourd’hui, la thèse selon laquelle le disciple Matthieu est l’auteur de l’évangile (9,9 et 10,3b) n’est plus défendue [14]. Certains exégètes pensent que Matthieu a « fait son autoportrait » dans le scribe « devenu disciple du royaume des cieux » (Matthieu 13,52) [15]. La grande majorité pense que Matthieu était sans aucun doute un juif. Probablement de Palestine, qu’il a pu être témoin de la guerre juive de 66-73. On trouve des allusions possibles à la destruction du temple de Jérusalem en l’an 70. Il pourrait appartenir à une communauté hellénistique, composée de juifs convertis et de gentils, ce qui expliquerait son bilinguisme. Pour certains, Matthieu est le témoin d’une transition douce entre le judaïsme et le christianisme [16]. Pour d’autres, Matthieu est le témoin d’une séparation consommée entre la communauté à laquelle s’adresse l’évangéliste et le judaïsme de son temps [17]. Certains spécialistes pensent que l’Église de Matthieu était importante, souvent identifiée à l’Église d’Antioche de Syrie [18].
Tous reconnaissent en Matthieu un génie bilingue. Il écrit en grec, pense en hébreu [19] et développe une très grande qualité de composition pour son écriture (voir les différentes propositions de plan ci-dessus). Il utilise un vocabulaire typiquement palestinien et le texte a pu être écrit en Syrie ou en Phénicie. Il y a des expressions typiquement matthéennes, par exemple « leurs synagogues – votre synagogue ». Elles prouvent que l’auteur est dans une situation non définie, encore mouvante et complexe. Il semblerait que les chrétiens ne vont déjà plus à la synagogue mais n’ont pas encore coupé les ponts avec le judaïsme officiel. « Il s’agit de frères ennemis non encore séparés » [20].
Les deux maisons
Les discours
Cinq discours rythment le livre de Matthieu :
- Chapitres 5 à 7 : le discours sur la montagne règlemente la vie pour ceux qui suivent Jésus. Relations humaines et relations avec Dieu.
- Au chapitre 10 : ordres et conseils à ceux qui partent annoncer la Bonne Nouvelle,
- puis au chapitre 13 : présentations de paraboles du royaume et clauses de la vie dans la future Église.
- Le chapitre 18 aborde comment vivre ensemble entre frères et sœurs dans une communauté chrétienne
- et les chapitres 24-25 : comment attendre la victoire finale ou les évènements eschatologiques.
Le discours du Sermon sur la montagne
Le « Sermon sur la montagne » est le premier des cinq discours de Jésus. Il représente presque un cinquième de l’évangile de Matthieu. C’est un joyau qu’il s’agit de lire entièrement, mais aussi à l’intérieur de l’évangile, afin de n’en pas perdre le sens. Le Sermon sur la montagne n’est pas le début de l’histoire de Jésus. D’après Matthieu, des disciples le suivent, des guérisons ont eu lieu. Le discours s’adresse à des chrétiens, lesquels viennent du judaïsme, et qui se demandent comment vivre harmonieusement la Loi de Moïse et sa mise en pratique à la lumière de l’exigence de Jésus.
Parabole des deux maisons
Qu’est-ce qu’une parabole ? Ce n’est en tout cas pas un message simplifié du Christ, des paroles pour les enfants. Au contraire, la parabole est difficile, « son vrai sens est réservé, non pas à l’intellectuel, mais au croyant » [21]. Jésus utilise la parabole pour trier les croyants des incroyants, pour donner une image du Royaume de Dieu… il emploie ce langage caché qui contraint à la recherche.
╬ Animation
Attention : nous étudions uniquement le texte de Matthieu 7 (pas de comparaison avec Luc ou autre source – pour le moment)
Avant d’entrer dans la parabole que nous connaissons peut-être, écrivons ce dont nous nous souvenons chacune pour soi. Restituer le texte biblique de tête aiguisera notre attention lors de la lecture qui suivra.
Mise en commun (avons-nous, ensemble, restitué tout le texte) : dessiner l’histoire façon bande dessinée
Lire le texte : (plusieurs traductions)
Travailler les sentiments : qu’est-ce que je n’aime pas ? Qu’est-ce qui me dérange ? Qu’est-ce qui me met mal à l’aise ?
Travailler l’intellect : Qu’est-ce qui distingue les deux personnes ? La tempête est-elle de même intensité ?
En groupe de 2 personnes, reconstituer le puzzle (télécharger le puzzle)
Quels versets pourrions-nous superposer ? Cet exercice nous fait découvrir la structure du texte.
Mathieu 7,24-27 « Donc tout (homme) qui écoute ces miennes paroles et les pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ils se sont précipités contre cette maison, et elle n’a pas croulé car elle avait été fondée sur le roc. Et tout (homme) qui écoute ces miennes paroles et ne les pratiquant pas sera comparé à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ils se sont heurtés contre cette maison et elle a croulé et sa chute était grande ».
Donc (oun) L’expression ne doit pas être négligée : la suite du texte introduite par « donc » est directement liée à ce qui précède, au minimum les versets 21 à 23 (traduction TOB) « Il ne suffit pas de me dire : ‘Seigneur, Seigneur !’ pour entrer dans le Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ? Alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité !’ » Ces paroles sont très dures ! Matthieu, préfère l’expression « Royaume des cieux » à celle de « Royaume de Dieu » des autres évangiles. La nature de ce Royaume et les modalités de son avènement sont longuement décrites dans les paraboles des chapitres 13 et 22. Le Royaume des cieux est déjà là, mais d’une façon cachée. Il est surtout une réalité paradoxale : avant d’être promis aux justes, il l’est aux pécheurs ; avant d’être promis aux Juifs, il l’est aux païens. Enfin, l’entrée dans le Royaume est exigeante, les richesses sont considérées comme un obstacle majeur [22].
Il faut faire la volonté de mon Père. Dans le discours de Jésus, il y a ceux qui parlent (« Seigneur ! Seigneur ! »)… et ceux qui font. Et parmi ces derniers, il y aura encore une distinction précisée plus tard.
mon Père qui est aux cieux. L’expression rappelle la prière « Notre Père… », donnée en Matthieu 6,9. Reconnaître Jésus comme Seigneur n’est pas suffisant, il faut aussi faire la volonté du Père. La puissance de Dieu est totale dans le ciel. Le ciel devient un modèle que la prière « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » évoque mal. Il vaudrait mieux dire « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est déjà au ciel ». Aujourd’hui, placer Dieu dans le ciel, c’est l’envoyer très loin de notre vie quotidienne. Or, il s’agit de le placer au cœur de nos choix et de notre vie : dans notre ciel intérieur !
Beaucoup me diront en ce jour-là… Faut-il comprendre l’expression « en ce jour-là » comme le jour du jugement ? Le texte rappelle Matthieu 25, 31 et suivants. Jésus replace toute la vie de l’homme chrétien dans la perspective du jugement dernier qui finalement révélera la manière dont la Parole du Royaume aura été mise en pratique [23].
Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ? Voilà l’autre catégorie de personnes mentionnée plus haut. Des personnes chassent les démons au nom de Jésus, elles font même des miracles, mais elles ne seront pas reconnues par Jésus lorsque le temps viendra de rendre des comptes ; et pour aider à apprendre à distinguer les prophètes des faux prophètes, Jésus donne deux images : les fruits des arbres (verset 15 à 20) et les deux maisons (versets 24 à 27).
Traduction TOB « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des buissons d’épines, ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et le jette au feu. Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Donc, quand un discours commence par « donc », il faut se prendre le temps de se souvenir de ce qui a été dit avant. Et « donc » ici devient presque menaçant : personne ne saurait se soustraire à l’avertissement qui va suivre.
Tout homme qui écoute mes paroles – mes paroles que voilà – ces miennes paroles (tous logous toutous aux versets 24, 26 et 28). Les paroles sont celles de Jésus : elles ont été déployées dans les trois chapitres précédents, dans son enseignement. L’expression insiste sur l’autorité de l’enseignement de Jésus. Nous avons lu depuis le verset 21, mais « ces paroles que voilà » font référence au début du discours (chapitre 5). Pour Matthieu, Jésus est le Messie que le peuple juif attendait. Ses paroles sont bien plus puissantes que les paroles de rabbins ou de prophètes. « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi et les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». L’affirmation de Jésus en Matthieu 5,17 se trouve être un passage particulier à Matthieu. L’auteur du livre de Matthieu veut prouver que Jésus de Nazareth est bien le Messie annoncé par les prophètes. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus reconnait l’autorité de la Torah et l’accomplit par son enseignement et sa manière d’être. L’enseignement de Jésus se termine, et l’auditeur, tout comme le lecteur actuel sont mis en face d’une grande alternative : celle de suivre les commandements et en conséquence, de recevoir les bénédictions… ou de ne pas mettre en pratique et d’encourir le malheur [24]. L’examen de conscience peut commencer.
Mettre en pratique /ne pas mettre en pratique – Faire /ne pas faire (poiein). Dans cet exemple, nous avons donc deux catégories de personnes : ceux qui écoutent les paroles de Jésus, les mettent en pratique… et ceux qui ne les mettent pas en pratique ; ils sont comparés tous deux à un homme qui construit sa maison. « Mettre en pratique », à la lumière de l’Ancien Testament, est très fortement lié au vocabulaire de l’Alliance contractée entre Dieu et son peuple. Mais ce qui est révolutionnaire dans le livre de Matthieu, c’est qu’on n’entre plus dans l’Alliance en appartenant au peuple d’Israël, mais en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Maître. Le déplacement théologique est considérable : le pilier de la foi n’est plus la Loi, mais la reconnaissance du Christ comme Messie, qui a autorité sur elle. Il y a ici une tension, car pour bien écouter, il ne faut rien faire (cela nous rappelle Marthe et Marie). Et l’auditeur est à l’écoute de l’enseignement de Jésus. Mais justement, pour Jésus, écouter ne suffit pas, il faut une mise en application, il faut faire. Le verbe poiein se trouve en Matthieu 5,19 et 46 ; 7,12, 24 et 26. Le verbe « faire » revient 9 fois dans les versets 13 à 27 ; lorsque la négation est associée au verbe, elle se teinte d’une notion menaçante. Pour ceux qui ne mettent pas en pratique, c’est la ruine qui leur est annoncée. La lecture de ces versets nous questionne (même aujourd’hui) : qu’elle action as-tu faite pour être témoin de ma Bonne Nouvelle, pour réaliser les volontés de mon Père ? [25] La pointe de la parabole est très précise et plutôt agressive : elle en veut à ceux qui écoutent mais ne mettent pas en pratique.
Sera comparé à un homme (omoiothesetai). Le grec utilise le futur pour dire que l’homme sera comparé (omoiothesetai)… l’expression n’est pas très logique en grec, car l’homme ne sera pas comparé dans une circonstance future, comme au jour du jugement. C’est maintenant (imparfait sémitique) que Jésus va dire à qui cet homme ressemble [26]. L’utilisation du futur indique le temps du jugement qui viendra… et le thème de la tempête qui surgit dans la suite du texte permet l’association d’idées avec le jugement [27].
Sage/fou. Le premier homme est qualifié de prudent, de sage (phronimos). Le deuxième constructeur est qualifié de fou, de stupide, d’insensé (moros). Il est facile de retenir cette parabole en utilisant les parallélismes antithétiques comme homme sage/homme fou ou bâtir sur roc/bâtir sur le sable. Mais pourquoi sont-ils qualifiés de sage et de fou ? Tous deux ont entendu l’enseignement de Jésus, tous deux construisent une maison… mais sur des terrains différents ! Et c’est le choix de ce terrain qui les qualifie de sage ou de fou.
Construire une maison. Dans la parabole de Matthieu, l’homme qui écoute l’enseignement de Jésus ressemble à l’homme construisant sa maison. L’exemple n’est pas absurde, l’homme est dans ce qu’il construit. Matthieu de donne pas de détails : l’homme est-il seul à construire ? A-t-il des amis ? des ouvriers ? Est-ce une grande maison ? ou une petite ? combien de pièces ? Pas de détail architectural : maison palestinienne ? romaine ? toit plat ? Ces détails n’ont aucune importance pour l’enseignement donné. Par contre, le choix du lieu de la construction est très important. Là est la sagesse de l’homme prudent qui a su choisir le bon fondement. Là est la folie de l’homme qui a construit sur le sable.
Roc/Sable. Matthieu met en scène deux sols différents : le roc et le sable. En Palestine, le roc propice à la construction ne manque pas. Le constructeur n’est pas spécialement intelligent, il fait ce qu’il y a à faire dans les conditions concrètes du sol palestinien. Le rocher (petra) y est propre à la construction en Galilée comme en Judée [28]. Luc utilise la même image, mais y ajoute bien plus de sueur car son constructeur avisé doit creuser et poser des fondations sur le roc. Cette partie de l’image est souvent comprise ainsi : on fait de la parole de Jésus le roc sur lequel édifier sa vie. Mais la pointe du texte est ailleurs : elle est dans le fait de mettre en pratique les paroles de Jésus [29]. Il n’est pas précisé comment ces deux constructeurs mettent en pratique la parole de Jésus. Le sable (ammos) dans l’Ancien Testament est qualifié de sable de mer, mais c’est aussi une terre meuble comme celle de l’Egypte. On peut songer en Galilée à ces terres légères qui sont au sud du lac ou dans la plaine de Génésareth. Choisir un pareil sol est insensé. C’est ainsi que la parabole de Matthieu est parfaitement cohérente. Personne dans le pays ne se soucie de faire des fondations profondes : le sage bâtit sur la roche, l’autre sur un terrain peu résistant [30]. L’un est qualifié de sage, l’autre de fou parce qu’ils ont choisi le terrain de construction [31]. Le fou aurait pu être sage s’il avait construit sa maison sur des pilotis, donnant ainsi des fondations solides à sa maison.
Et… L’écrivain grec a placé 14 fois cette conjonction (kai), elles donnent du rythme à l’histoire et tiennent le lecteur en haleine.
Pluie, torrents, vents. Arrivent la pluie, les torrents et les vents. La pluie (broke) peut désigner la pluie d’irrigation ou la pluie orageuse. Ici pas de doute, c’est bien d’une pluie d’orage qu’il s’agit. Les torrents (potamoi) sont les torrents de la mauvaise saison palestinienne (de décembre à mars). Ils se forment pendant les grosses pluies, sont imprévisibles et surtout, ils emportent tout sur leur passage [32]. Les vents (anemoi) sont la dernière calamité météorologique de l’histoire. Certains les comprennent comme des tourbillons locaux [33]. Le père Lagrange préfère y voir une météorologie normale et connue des habitants du bord du lac de Galilée « Il est rare que le vent renverse une maison. Mais outre que le vent est l’accompagnement inéluctable des grandes pluies, il est quelquefois assez violent pour abattre des toits et même des murs en terre battue, comme nous l’avons vu à Jéricho en 1912 » [34]. Bref, ce sont les grosses bourrasques de vent et de pluie mêlées. L’image de la tempête, dans l’AT, désigne souvent la colère et la condamnation divines. Attention à une interprétation hâtive ! Cette tempête ne fait probablement pas allusion aux difficultés courantes de la vie (maladie, deuil, adversités diverses). Les versets 25 et 27 sont des parallélismes exacts selon les habitudes sémitiques. Et introduisent deux conclusions différentes…
Se sont précipités contre / sont venus battre (prosepesan) / (prosekopsan). Le radical de ce verbe est utilisé à deux reprises. Et pourtant, la nuance pourrait induire que l’intensité de la tempête était grande, bien plus grande que la seconde tempête. Le plus important, c’est la suite.
Elle n’a pas croulé car elle avait été fondée sur le roc – Elle a croulé et sa chute était grande. Le résultat de l’histoire est différent par rapport à l’attitude du début ! Une maison en place pour l’un, une maison écroulée pour l’autre propriétaire. Les derniers mots du discours produisent un effet chez le lecteur que nous sommes. « Il n’est pas possible d’échapper à une réflexion sérieuse sur l’enjeu vital qui accompagne la décision inéluctable de conformer ou non son existence à l’enseignement de Jésus » [35]. Ce qui est clairement mis en avant dans cet enseignement, c’est l’action éclairée après l’écoute de l’enseignement de Jésus. Après le Sermon sur la montagne, un temps nouveau a commencé. Un temps qui ne détruit pas le monde existant, dans lequel nous sommes appelés à vivre intelligemment, qu’il faut gérer, pour soi et pour les autres en attendant la fin. Ici un appel est fait à l’intelligence, par opposition à la bêtise. Il est intelligent et profitable d’écouter la parole de Dieu et celui qui l’explique avec clarté, Jésus.
- Les deux maisons chez… Elicha ben Abouyà
Vers 130 après JC Elicha ben Abouya disait « Celui qui a beaucoup de bonnes œuvres et sait bien résoudre les difficultés d’après la Loi, à qui ressemble-t-il ? A un homme qui en construisant met d’abord des blocs de pierre, puis des briques. Les flots qui viennent battre la construction ne peuvent l’entrainer de sa place. Au contraire celui qui a de grandes connaissances de la Loi, mais peu de bonnes œuvres, à qui ressemble-t-il ? A un homme qui en bâtissant met d’abord les briques, puis ensuite les blocs ; le bâtiment tombe pour un peu d’eau » [36]. D’après Lagrange, cette citation rabbinique ne pourrait être la source de la parole de Jésus, au contraire ! Elle aurait été utilisée par Elicha pour développer la pensée de Jésus.
… et chez Luc 6,47-49. Dans Matthieu, comme dans Luc, la réinterprétation de la loi par Jésus se termine par cette parabole : « Tout (homme) venant à moi et écoutant mes paroles et les pratiquant, je vous montrerai à qui il est comparable. Il est comparable à un homme bâtissant une maison, qui a creusé et approfondi et a posé le fondement sur le roc. Une crue s’étant produite, le torrent s’est rué contre cette maison et il n’a pu l’ébranler, pour cela (qu’) elle avait été bien bâtie. Mais celui qui a écouté et n’a pas pratiqué est comparable à un homme ayant bâti une maison sur la terre, sans fondement, contre laquelle s’est rué le torrent, et aussitôt elle s’est écroulée et la ruine de cette maison fut grande. »
Les différences de contenu entre les deux versions de la parabole :
- Luc décrit avec force détails la technique de construction : il faut creuser, excaver profondément avant de poser les fondations. Chez Matthieu, pas autant d’efforts ! La solidité de la maison matthéenne dépend du fondement (roc) alors que chez Luc, l’accent est mis sur la construction (décrit par trois verbes : creuser, approfondir, fonder sur le roc).
- Matthieu décrit les pluies torrentielles de la Palestine, alors que Luc dépeint une inondation venant de la crue d’un cours d’eau.
- Enfin, Matthieu détaille l’intempérie pour arriver à une chute, alors que Luc parle de ruine. Il est certain que les auteurs ont adapté la parabole aux conditions géologiques et climatiques de leur milieu.
- Pour Luc il faut prendre de la peine. De même que quiconque n’a pas pris la peine de creuser des fondations est exposé à voir tomber sa maison au jour de l’inondation, ainsi le disciple qui ne pratique pas résolument ce que le Christ a enseigné se laissera emporté par l’épreuve.[38] Pour Matthieu, le message est de mettre en pratique l’enseignement de Jésus.
- Matthieu a répété son texte sans avoir peur de lasser son auditoire : au contraire, ses répétitions permettent de s’en souvenir par cœur : c’est un procédé mnémotechnique rabbinique. Chez Luc, l’histoire est la même, mais le parallélisme bien moins grand. Ce qui fait dire aux spécialistes que l’écriture de Luc est plus tardive que celle de Matthieu [39].
Conclusion
Finalement, quelle actualisation tirer de l’enseignement de Jésus ? Tous entendent l’enseignement de Jésus. Certains mettent en pratique cet enseignement… et ils vivront heureux. La conclusion renvoie au début de la parabole, ces gens-là seront comparés à un homme sage. D’autres ne mettent pas en pratique les paroles entendues, leur folie n’est pas de ne pas avoir discerné les paroles de Jésus, mais d’en n’avoir rien fait. Et pour eux, la chute sera grande. A la lumière de 1 Corinthiens 10,4, la tradition de l’Eglise a souvent interprété cette parabole comme une allégorie, affirmant que le roc, c’était Jésus [40], lecture devenue courante chez les réformateurs. Mello ose une double conclusion « La parole, c’est l’écoute. La roche c’est la pratique. Une écoute qui n’a pas de fondation s’évanouit. La foi doit s’enraciner dans l’amour. Mais peut-être que la parabole de Matthieu est une parabole en acte : la maison c’est le discours sur la montagne, au terme duquel nous sommes arrivés, et la roche c’est la ‘Loi et les Prophètes’ sur lesquels il est fondé : il ne peut y avoir d’écoute des paroles de Jésus qui ne tienne compte de l’Ancien Testament. L’enseignement de Jésus est ‘l’accomplissement’ de la construction, mais ses fondations incontournables sont celles-là même que le Père avait déjà mises en place par la bouche de Moïse et des prophètes » [41]. Pour Thayse, « Mettre en pratique, c’est aller à la rencontre de la réalité quotidienne, c’est s’immerger dans la vie, vocation de chaque homme… Le génie de Jésus a été de percevoir que c’est dans la vie ordinaire la plus simple, dans des actes accessibles à tous, et donc compréhensibles par tous, que se joue et se construit la vie, que se parcourt le chemin où ‘la vie de l’ego va se changer en celle de Dieu lui-même’ (M. Henry) » [42]. Pour Suzanne de Dietrich, « Jésus veut être obéi ; croire en lui, c’est accepter de se laisser constamment juger et rappeler à l’ordre par sa parole ; c’est naître à cette vie de l’amour que lui seul peut créer en nous ; c’est vivre jour après jour le du pardon de Dieu… » [43]. Roux de son côté est affirmatif « Autrement dit, la foi qui ne produit pas les œuvres n’est pas la foi ; et, inversement, les œuvres ne peuvent pas exister sans la foi… mais pouvons-nous délibérément nous ranger de nous-mêmes et avec sérénité du côté de ceux qui écoutent la Parole et la mettent en pratique ? » [44]
Actualisation d’écriture : « Celui qui entend vraiment les paroles que je dis et les transforme en actes est semblable à un maçon qui construit sur le roc : bien des cataclysmes surviendront, mais la maison résistera. Celui qui m’entend sans m’entendre, qui ne transforme pas les intentions en actes, est semblable au maçon qui construit sur le sable : si les mêmes cataclysmes surviennent, la maison de sa vie sera emportée » [45].
La conclusion du Sermon sur la montagne, versets 28-29, développe ce que la parabole a commencé : « Quand Jésus eu achevé ces instructions, il arriva que les foules étaient hors d’elles-mêmes du fait de son enseignement ; c’est qu’il enseignait avec autorité, non comme leurs scribes » [46].
Bibliographie
AESCHIMANN André, Pour qu’on lise les Paraboles, Les Bergers et les Mages, 1964
ALBRIGHT WF and MANN CS, Matthew, introduction, translation, and notes, Doubleday & Company, 1971
BARLOW Michel, L’Evangile en relief, Matthieu. Pistes bibliques tout au long de l’année liturgique (Année A), collection Parole Vive, Editions Olivétan, 2016
BENOIT Pierre et BOISMARD Marie-Emile, Synopse des quatre évangiles en français, avec parallèle des apocryphes et des Pères, tome 1 Textes, Les éditions du Cerf, 1979
BONNARD Pierre, L’évangile selon Saint Matthieu, Commentaire du Nouveau Testament 1, Labor et Fides, Genève 2002
CUVILLIER Élian, ‘Évangile selon Matthieu’, in Le Nouveau Testament commenté, texte intégral TOB, sous la direction de Camille FOCANT et Daniel MARGUERAT, Bayard, Labor et Fides, 2012
DE DIÉTRICH Suzanne, Mais moi, je vous dis. Commentaire de l’Evangile de Matthieu, Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1965
DUMAIS Marcel, Le Sermon sur la Montagne, Etat de la recherche, Interprétation, Bibliographie, Letouzey et Ané, 1995
DURAND Alfred, Evangile selon Saint Matthieu, Beauchesne ed. 1938
JAY Bernard, Introduction au Nouveau Testament, Collection théologique CLE, éditions Clé, Yaoundé, 1969
LAGRANGE MJ, Évangile selon Saint Matthieu, Gabalda et Cie éditeurs, 1948
LOISY Alfred, Les évangiles synoptiques, tome 1, Ceffonds, 1907
LUZ Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7), EKK, Benziger, Neukirchener, 2002
MAILLOT, Les paraboles de Jésus, Labor et Fides, Cerf, 1993
MELLO Alberto, Évangile selon saint Matthieu, commentaire midrashique et narratif, Lectio Divina 179, Les éditions du Cerf, 1999
PARMENTIER Roger, L’évangile autrement. L’évangile de Matthieu et l’apocalypse relus pour notre temps, Editions Le Centurion, 1977
ROUX Hébert, L’Evangile du Royaume. Commentaire sur l’Evangile selon saint Matthieu. Editions Labor et Fides, Genève, 1956
SCHWEIZER Eduard, Das Evangelium nach Matthäus, NTD band 2, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1986
THAYSE André, Matthieu, l’évangile revisité, Editions Racines, collection Lumen Vitae, 1998
TOB – Traduction Œcuménique de la Bible, La Bible, Bibli’O, Société biblique française et éditions du Cerf, 2015
[1] Léon-Dufour, Introduction XV,3
[2] Jay, page 87
[3] Mello, page 23-24
[4] Jay, page 95
[5] Les spécialistes actuels abandonnent de plus en plus la théorie d’une seconde source appelée « Paroles de Jésus » ou « Logias » ou « Source Q » (du mot allemand Quelle = source). Matthieu et Luc auraient utilisés cette collection de paroles, ce qui expliquerait les points en communs entre ces évangiles.
[6] TOB, Introduction à Matthieu
[7] TOB, Introduction à Matthieu, page 1611
[8] Jay, pages 96-97
[9] Bonnard nomme Léon-Dufour, page 7
[10] TOB, Introduction à Matthieu
[11] TOB, Introduction à Matthieu
[12] TOB, Introduction à Matthieu, page 1613
[13] TOB, Introduction à Matthieu
[14] Cuvillier, page 22
[15] Mello, page 15
[16] Mello, page 52 cite K. Stendahl « The School of St Matthew and Its Use for the Old Testament »
[17] Cuvillier, pages 22-23
[18] Jay, page 106
[19] Mello, page 16
[20] Bonnard, page 3
[21] Maillot, page 10
[22] Jay, page 103
[23] Roux, page 88
[24] Dumais, page 306
[25] Bonnard, page 107 « Ces versets ne décrivent pas une loi psychologique selon laquelle l’obéissance à la loi renouvelée assurerait la solidité de l’homme ; ils sont un avertissement prophétique adressé à des auditeurs déjà menacés par un certain quiétisme spirituel. »
[26] Lagrange, page 157
[27] Dumais, page 306
[28] Lagrange, page 157
[29] Bonnard, page 109
[30] Lagrange, page 158
[31] Bonnard, page 109 Attention. Il ne faudrait pas y voir une allusion aux passions, désirs, bonnes volontés fragiles de la vie sans Dieu
[32] Lagrange, page 157
[33] Bonnard, page 109
[34] Lagrange, page 157
[35] Dumais, page 306
[36] Lagrange, pages 158-159
[37] Benoit et Boismard, paragraphe 75
[38] Lagrange, page 158
[39] Dumais, page 305
[40] Dumais, pages 306-307
[41] Mello, page 152
[42] Thayse, pages 67-68
[43] De Diétrich, page 58
[44] Roux, page 89
[45] Parmentier, page 38
[46] Bonnard, page 110
Crédit, Laurence Gangloff (UEPAL) – Point KT
 Texte : Actes des Apôtres 8/26-39
Texte : Actes des Apôtres 8/26-39 Narration ; la Fiche biblique est à télécharger
Narration ; la Fiche biblique est à télécharger 
 Psaume 4, 9 : Le sommeil du juste !
Psaume 4, 9 : Le sommeil du juste ! Étude de Matthieu 7,24-27 : les deux maisons. Voici une parabole que l’on raconte volontiers aux enfants… et si les adultes l’étudiaient… qu’en feraient-ils ?
Étude de Matthieu 7,24-27 : les deux maisons. Voici une parabole que l’on raconte volontiers aux enfants… et si les adultes l’étudiaient… qu’en feraient-ils ? Les derniers livres prophétiques dans nos bibles, Aggée, Zacharie et Malachie, se situent tous trois durant une période bien précise, celle du retour de l’exil à Babylone. Voici une Introduction générale, et des notes pour les moniteurs :
Les derniers livres prophétiques dans nos bibles, Aggée, Zacharie et Malachie, se situent tous trois durant une période bien précise, celle du retour de l’exil à Babylone. Voici une Introduction générale, et des notes pour les moniteurs : La version de J.N. Darby du texte de Genèse 11 :
La version de J.N. Darby du texte de Genèse 11 : Un travail biblique extrêmement fouillé qui pourra servir à diverses animations catéchétiques. On peut rechercher un certain nombre de documents iconographiques sur Internet, en plus de ceux déjà présent dans le document. Bien au-delà du portrait archéologique, historique et architectural de la ville, de ces habitants et de ces divinités, cette synthèse aborde la thématique des hébreux en exil, la politique de Nabuchodonosor et celle de Cyrus, le Messie perse. La fiche introduit aussi les références bibliques et symboliques de Babylone dans le Nouveau Testament et le christianisme.
Un travail biblique extrêmement fouillé qui pourra servir à diverses animations catéchétiques. On peut rechercher un certain nombre de documents iconographiques sur Internet, en plus de ceux déjà présent dans le document. Bien au-delà du portrait archéologique, historique et architectural de la ville, de ces habitants et de ces divinités, cette synthèse aborde la thématique des hébreux en exil, la politique de Nabuchodonosor et celle de Cyrus, le Messie perse. La fiche introduit aussi les références bibliques et symboliques de Babylone dans le Nouveau Testament et le christianisme.








 Les textes bibliques – qui sont pour nous, et dans la foi, Parole de Dieu – ne nous appartiennent pas…
Les textes bibliques – qui sont pour nous, et dans la foi, Parole de Dieu – ne nous appartiennent pas… « Le récit de Joseph, qu’il soit en paix », de Ibn CIsa Ahmad : (Zulaykha lui dit) : « Oh Joseph, rien n’égale le noir de tes yeux, ni le noir de tes cheveux, ni les fossettes de tes joues. Aucun parfum n’est aussi pur que le tien, aucune démarche aussi innocente. […] Soumets-toi à moi et je me convertirai à l’Islam avec ton aide » […] La nouvelle se répandit dans Misr parmi toutes les dames qui s’écrièrent : « Zulaykha aime un des adolescents ! » Zulaykha invite alors l’épouse du ministre du Souverain, l’épouse de son chancelier, l’épouse de son vicaire et l’épouse de son trésorier. À chacune elle présente un citrus et un couteau et leur dit : « Jurez-moi toutes que si Joseph venait à vous et vous le demandait, vous lui donneriez chacune une part de citrus… » […] Il ressemblait à l’astre lunaire dans sa nuit de plénitude. Quand les femmes le virent, elles se troublèrent et perdirent la raison à la vue de sa beauté. « Ce n’est pas un être humain, on dirait un ange par son essence ! » Elles ressentirent un tel trouble qu’elles se tailladèrent les mains…
« Le récit de Joseph, qu’il soit en paix », de Ibn CIsa Ahmad : (Zulaykha lui dit) : « Oh Joseph, rien n’égale le noir de tes yeux, ni le noir de tes cheveux, ni les fossettes de tes joues. Aucun parfum n’est aussi pur que le tien, aucune démarche aussi innocente. […] Soumets-toi à moi et je me convertirai à l’Islam avec ton aide » […] La nouvelle se répandit dans Misr parmi toutes les dames qui s’écrièrent : « Zulaykha aime un des adolescents ! » Zulaykha invite alors l’épouse du ministre du Souverain, l’épouse de son chancelier, l’épouse de son vicaire et l’épouse de son trésorier. À chacune elle présente un citrus et un couteau et leur dit : « Jurez-moi toutes que si Joseph venait à vous et vous le demandait, vous lui donneriez chacune une part de citrus… » […] Il ressemblait à l’astre lunaire dans sa nuit de plénitude. Quand les femmes le virent, elles se troublèrent et perdirent la raison à la vue de sa beauté. « Ce n’est pas un être humain, on dirait un ange par son essence ! » Elles ressentirent un tel trouble qu’elles se tailladèrent les mains…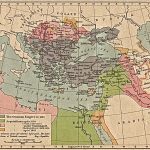 Le récit d’Ibn CIsa Ahmad, inspiré de l’histoire de Joseph, et étudié par Faïka Croisier*, est écrit à la fin du règne de Soliman le Magnifique, Soliman le Législateur. L’empire ottoman est à son apogée (
Le récit d’Ibn CIsa Ahmad, inspiré de l’histoire de Joseph, et étudié par Faïka Croisier*, est écrit à la fin du règne de Soliman le Magnifique, Soliman le Législateur. L’empire ottoman est à son apogée ( Nous avons déjà beaucoup de travail, comme moniteurs et catéchètes, à témoigner de notre foi chrétienne sur base de la Bible que nous connaissons (un peu). Peut-être à certains moments, pourrons-nous lire certains textes dans le Coran, juste pour voir… Peut-être aurons-nous l’occasion d’entrer dans un groupe de dialogue interreligieux ? Peut-être pourrons-nous nous pencher sur l’Histoire, celle du passé qui précède notre actualité et qui bien souvent nous éclaire sur le présent ?
Nous avons déjà beaucoup de travail, comme moniteurs et catéchètes, à témoigner de notre foi chrétienne sur base de la Bible que nous connaissons (un peu). Peut-être à certains moments, pourrons-nous lire certains textes dans le Coran, juste pour voir… Peut-être aurons-nous l’occasion d’entrer dans un groupe de dialogue interreligieux ? Peut-être pourrons-nous nous pencher sur l’Histoire, celle du passé qui précède notre actualité et qui bien souvent nous éclaire sur le présent ?