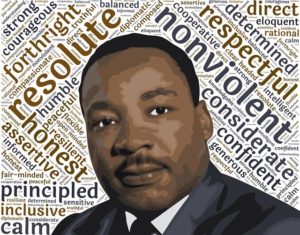Découvrir les récits de l’Exode avec des œuvres d’art
Parcours biblique en images en lien avec le livre de l’Exode et le jeu Exode Aventures. Ce matériel préparatoire est pour les jeunes et les adultes. Descendre de quelques pages pour découvrir l’animation pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Marc CHAGALL 1887-1985 : une biographie
- 1887-1911 De Vitebsk à St-Pétersbourg : enfance en Russie
Chagall naît en 1887 dans la petite ville de Vitebsk, annexée par l’empire russe en 1772.
Sa famille appartient à une communauté juive, très attachée à Dieu à travers le chant et la danse.
A sa demande, sa mère l’inscrit à l’école d’art de Vitebsk.
Vitebsk, sa famille, les traditions juives marqueront résolument Chagall et sa peinture.
En 1906, à 19 ans, Chagall quitte Vitebsk pour St-Pétersbourg, où il survit en exerçant des petits métiers. Un mécène le prend en charge, ce qui lui permet de s’inscrire à l’école des Beaux-Arts.
Il s’intéresse alors particulièrement au travail de la couleur.
En 1909, il rencontre Bella Rosenfeld qui restera l’amour de sa vie.
- 1911-1914 A Paris
Deux ans plus tard, il obtient une bourse et part pour Paris où il découvre les grands peintres exposés au Louvre mais aussi Van Gogh, Matisse, Renoir Manet ainsi que les premiers peintres cubistes et futuristes.
Installé à l’atelier la Ruche, il peint avec une très grande créativité et expose au Salon des Indépendants. Cependant, il ne vend presque rien.
- 1914-1922 Retour en Russie
De retour à Vitebsk en 1914, Chagall continue à peindre en particulier sa famille et il fait le portrait de nombreux amis juifs qui l’entourent. Il se marie avec Bella en 1915.
Nommé commissaire aux Beaux-Arts de sa ville, il crée avec succès une académie et un musée mais suite à des désaccords avec le peintre Malevitch, il démissionne.
En 1920, il se rend à Moscou où il reçoit ses premières commandes de décors de théâtre.
Il réalise des décors immenses mais, suite à des divergences avec le directeur du théâtre juif Kamerny, il démissionne.
En 1922 Chagall quitte la Russie pour Berlin.
- 1922-1941 De Paris en Orient
Avec sa famille, Chagall se rend à Paris à l’invitation du marchand d’art Ambroise Vollard. Celui-ci lui commande des illustrations. Chagall, fasciné par le cirque, dessine jongleurs et acrobates. Il illustre ensuite les fables de La Fontaine. En 1930, il commence une série d’illustrations sur la Bible. Les récits bibliques resteront une source d’inspiration fondamentale pour Chagall tout au long de sa vie.
En 1931, Chagall entreprend un long voyage en Orient à travers l’Égypte, la Syrie, la Palestine…
Dans ce voyage, il affirme avoir trouvé « la Bible et une part de lui-même. »
En 1937, Chagall obtient la nationalité française et, en 1940, la famille se réfugie dans le sud de la France, à Gordes, lorsque les évènements se précipitent en Europe et que les juifs sont de plus en plus inquiétés.
- 1941-1948 L’exil américain
En 1941 Chagall et sa famille réussissent à partir pour New York où ils retrouvent d’autres peintres en exil : Fernand Léger, Pierre Matisse… En 1944 la mort de sa chère Bella le terrasse et le rend incapable de peindre pendant plusieurs mois.
A New York, sa peinture est appréciée et en 1946 le MoMa (Museum of Modern Art) organise une rétrospective de ses œuvres. Suivront alors d’autres expositions à Paris, Londres…
- 1948-1985 A Vence, dans le sud de la France
Revenu en France en 1948, Chagall s’installe à Vence, près de Nice. Il y épouse Valentina Brodsky en 1952.
A cette période, il explore la céramique dans le même atelier que Picasso, ainsi que la sculpture.
En 1959, Chagall commence le cycle des 17 tableaux du Message biblique destinés à la chapelle du calvaire à Vence. Ces tableaux seront donnés à l’État français en 1966.
En 1962, André Malraux, alors ministre des affaires culturelles, lui confie la conception du nouveau plafond de l’opéra de Paris, un chantier qui dure 2 ans et dans lequel Chagall exprime pleinement son style unique et son indépendance en termes de formes et de couleurs.
Le musée national Chagall s’ouvre à Nice en 1973.
Chagall meurt en 1985 alors que se prépare une grande rétrospective de ses œuvres à Londres.
Son rapport personnel au texte biblique
Marc Chagall est un artiste aux talents multiples : peinture, gravure, lithographie, vitrail…
On peut rencontrer son œuvre dans des musées, des églises ou des chapelles en Europe ou aux États-Unis, dans des livres d’art… jusqu’au plafond de l’opéra Garnier.
« Avec les livres de prière de ses parents, le livre prit naissance dans la vie du jeune Chagall ». L’éducation de Chagall a été religieuse : il a grandi dans le hassidisme, une forme de religion populaire qui privilégie la relation spontanée avec Dieu et met en avant la profonde unité du monde, la présence de Dieu en tout et partout. Si Dieu, l’âme et l’univers sont divisés, c’est une conséquence du péché de l’être humain ; mais l’acte original de création les concevait comme un ensemble de trois éléments en étroite relation. Chagall, esprit religieux, spectateur émerveillé de l’univers, voit ainsi sans effort, spontanément, les êtres et les choses entraînées dans un mouvement perpétuel, où il n’y a ni haut ni bas, où le naturel et le surnaturel se mêlent, ou le sentiment amoureux et le sentiment religieux participent d’un même amour. Ces toiles, pleines de personnages en mouvement ou même parfois à l’envers en témoignent.
Marc Chagall est inscrit dans la culture juive où la beauté de l’écriture sur le parchemin des rouleaux de la Torah fait corps avec le sacré. Sa vie de peintre et de dessinateur a été consacrée à cette recherche de message du sacré dans le trait même. La ligne de conduite de Chagall a consisté à innover constamment dans son vocabulaire visuel et pictural. Une manière, pour lui, de répondre à l’appel qui consiste à se présenter « aujourd’hui devant l’Éternel » (Deutéronome 29,9) car « l’Éternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains (Deutéronome 28,12).
La manière de peindre de Chagall a beaucoup évolué. Il a travaillé à ce que « chaque trait et volume révèlent, à travers leur authenticité, leur densité et au-delà de l’illustration, tout le message sacré inné ».
Après lui avoir fait illustrer les fables de La Fontaine, son éditeur, Ambroise Vollard, lui demande de travailler sur la Bible. L’élan qui anime alors le travail de Chagall prend très certainement naissance dans les pratiques religieuses de la communauté juive de Vitebsk et dans la pratique familiale : ses oncles qui lisent la Bible et chantent ; sa mère qui l’envoie étudier la Bible chez un « petit Rabi de Mohileff ». Les lectures, les prières, les cérémonies donnent à Chagall une familiarité avec l’histoire millénaire du peuple juifs et ses héros. L’épopée biblique baigne l’ordinaire des jours.
Ce rapport intime avec les figures bibliques naît de la fréquentation du Livre Saint. La mémoire est nourrie de ses récits, elle modèle les comportements. Dans Ma vie, Chagall raconte que le père, avant d’aller à la Synagogue, souligne pour la mère les passages à lire et ceux où il faut pleurer, « le premier souvenir révèle déjà le lien particulier, indissociable, entre le livre et la vie quotidienne, entre texte et image, entre l’écrit et le visuel, qui s’avère essentiel dans l’œuvre de Chagall. »
Mais au moment où il faut se mettre à l’œuvre et susciter ses figures qui sont aussi familières que les membres de sa famille, Chagall estime, au regard de ce qui est en jeu, qu’un voyage à Jérusalem est nécessaire. Il part avec sa femme est sa fille en 1931 et visite notamment Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, Safed. L’idée est, pour l’artiste, de vérifier son appartenance à cette terre, à ses couleurs, à sa lumière. À peine Chagall a-t-il passé la frontière que les inscriptions lui « rappellent d’un seul coup le roi David jouant de la harpe ». Pour le peintre, le choc avec cette réalité ne finira pas d’avoir des répercussions sur son œuvre, sur le sens qu’il y attache, et en premier lieu sur le travail de graveur, qu’il entreprend à son retour en marge de ses illustrations pour la Bible.
Chagall « fait corps » avec son sujet, il fait en sorte que la Parole se propage à travers son langage pictural. Son imagination se renouvelle sans cesse au contact du texte sacré et il tente de suggérer avec toujours plus de subtilité et de créativité la présence de l’Éternel.
Sa première Bible est constituée de 66 eaux-fortes gravées jusqu’en 1939 puis complétées en 1952 et 1956 par 39 autre œuvres dont la facture est très différente : plus grave, plus engagées encore. Entre la guerre et les changements d’éditeurs, les deux volumes consacrés à la Bible ne paraîtront qu’en décembre 1956.
« Depuis ma première jeunesse, j’ai été captivé par la Bible. Il m’a toujours semblé et il me semble encore que c’est la plus grande source de poésie de tous les temps. Depuis lors, j’ai cherché ce reflet dans la vie et dans l’Art. La Bible est comme une résonance de la nature et ce secret j’ai essayé de le transmettre. »
Évoquant le musée national à Nice où sont déposées ses œuvres qui concernent le message biblique, Marc Chagall déclare : « J’ai voulu les laisser dans cette Maison pour que les hommes essaient d’y trouver une certaine paix, une certaine spiritualité, une religiosité, un sens de la vie. Ces tableaux, dans ma pensée, ne représentent pas le rêve d’un seul peuple mais celui de l’humanité (…) »
« La peinture, la couleur, ne sont-elles pas inspirées par l’amour ? »
Pour Chagall, la couleur est une chose innée, elle dépasse la dextérité avec laquelle on peut manier un pinceau. La couleur, avec ces lignes, fait apparaître le caractère et le message de chacun.
« Si toute la vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. Dans cet amour se trouve la logique sociale de la vie et l’essentiel de chaque religion. Pour moi, la perfection dans l’Art et dans la vie est issue de cette source biblique. Sans cet esprit, la seule mécanique de logique et de constructivité dans l’Art comme dans la vie ne porte pas de fruits.
Peut-être dans cette Maison viendront des jeunes et les moins jeunes chercher un idéal de fraternité et d’amour tel que mes couleurs et mes lignes l’ont rêvé. Peut-être aussi prononcera-t-on les paroles de cet amour que je ressens pour tous. Peut-être n’y aura-t-il plus d’ennemis et comme une mère avec amour et peine met au monde un enfant, ainsi les jeunes et les moins jeunes construiront le monde de l’amour avec un nouveau coloris.
Et tous, quelle que soit leur religion pourront y venir et parler de ce rêve, loin des méchancetés et de l’excitation.
Je voudrais aussi qu’en ce lieu, on expose des œuvres d’art et des documents de haute spiritualité de tous les peuples, qu’on entende leur musique et leur poésie dictées par le cœur.
Ce rêve est-il possible ? mais dans l’art comme dans la vie tout est possible si, à la base il y a l’Amour. »
Une bibliographie des ouvrages de référence
- Sylvie Forestier, Petit guide du Musée National, Message biblique, Marc Chagall, éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, avril 1997/mars 2008.
- Jean-Michel Foray et Françoise Rossini-Paquet, Introduction à l’album du Musée National, Message biblique, Marc Chagall, éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2010.
- Chagall et Tériade, l’empreinte d’un peintre, Musée Matisse – Le Cateau Cambrésis, Feuille à Feuille, 2006.
- Chagall et la Bible, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Skira, Flammarion, 2011
- Jean-Michel Foray, Le petit dictionnaire Chagall en 52 symboles, éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, Paris 2013
- Jacob Baal-Teshuva, Chagall, Taschen, 2003
- Julia Garimorth-Foray (dir), Chagall entre guerre et paix, Musée du Luxembourg, exposition organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2013.
- « La bible et l’art contemporain » Méromédia, 2003
- « Bible et œuvre d’art en regard » parcours pour une catéchèse en image, Méromédia, 2005
Œuvres, commentaires et pistes de réflexion
Moïse devant le buisson ardent (1960-1966), Exode 3, 1-10
voir l’œuvre « Moïse et le buisson ardent »
Pour les enfants
- Que vois-tu et que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- D’après toi, qui est le personnage en blanc ?
- A quoi reconnais-tu Moïse ?
- Combien de fois le vois-tu ?
- Quelles différences entre les deux dessins ?
- Qu’est-ce qui est au centre de la scène ?
- Que vois-tu au-dessus du buisson ?
Pistes pour les ados
- Dieu a parlé à Moïse dans le Buisson, comment te parle-t-il aujourd’hui ?
- Un buisson qui brûle sans se consumer, c’est quoi ça ?
Compléments possibles via la peinture
- Dans ce tableau, sorte de résumé de l’histoire de Moïse
- Grandes étapes de la vie : constitution de l’identité (personnelle et communautaire, vocation, capacité à changer, choix de vie)
- Question de la communauté d’appartenance : différence entre le peuple constitué derrière Moïse, en ordre de marche et d’application de la Loi – tournée vers elle – et les égyptiens en ordre dispersés
Informations pour les adultes
- Trois figures verticales scandent la composition qui met en scène deux épisodes fondateurs de l’histoire de Moïse de chaque côté du buisson ardent, au centre du tableau.
- Si on lit de droite à gauche (comme l’hébreu) l’artiste évoque d’abord la vie tranquille de Moïse dans les pâturages du pays de Madian (en haut à droite). Près de Moïse, dans la partie droite du tableau, Aaron son frère, reconnaissable à son pectoral.
- Face au buisson ardent Moïse est tombé à genoux. Le patriarche, en vieillard au visage très ridé, a une expression de béatitude.
- Il porte la main à son cœur pour manifester humblement sa surprise craintive, tel Marie dans une annonciation, et paraît transfiguré alors qu’il écoute la voix et reçoit sa mission d’aller auprès du Pharaon pour faire sortir le peuple d’Égypte.
- Chagall identifie toujours Moïse par des rayons, symboles de la lumière que son visage irradie lorsqu’il descend avec les tables de la loi du mont Sinaï.
- Le buisson ardent est au centre du tableau. Un ange au-dessus matérialise la voix de Dieu s’adressant au prophète. Il est figuré dans un cercle évocateur des mandorles qui soulignent la présence divine au fronton des églises romanes. Les couleurs du buisson en feu reprises dans cette double auréole sont celles de l’arc-en-ciel. Chagall symbolise ainsi le rappel du dialogue entre Dieu et les êtres humains, le rappel de l’Alliance.
- La partie gauche du tableau évoque la sortie d’Égypte, la traversée de la mer Rouge. La haute tête de Moïse, éclairée par la lumière divine, est tournée vers l’extérieur du tableau, c’est-à-dire vers ce qui l’appelle. Devant lui, les tables de la loi qu’il n’a pas encore reçues mais qui l’investissent déjà de toute l’autorité sur le peuple juif. Son manteau, c’est le peuple juif, c’est sa chair. La vague qui se referme derrière lui est également évocation de la nuée divine qui accompagne les Hébreux dans leur marche. Elle les protège contre l’armée de pharaon dont la colère est soulignée de rouge et de mouvements frénétiques. La vague est en train d’engloutir l’armée égyptienne, les chars sont disloqués. À la sérénité de la marche du peuple hébreu s’oppose la dramatique fin de l’armée du pharaon.
Chagall réunit deux épisodes du récit biblique, celui du buisson ardent, et celui du passage de la mer Rouge.
Sébastien Bourdon (1616-1671)
Bourdon est un peintre protestant né à Montpellier qui a beaucoup voyagé en vivant de sa peinture avant d’arriver à Rome en 1634. Il se distingue alors par son talent de contrefacteur des grands maîtres. Il quitte Rome à la suite d’une querelle avec un autre peintre qui menace de le dénoncer à l’Inquisition et s’installe à Paris.
Il peint le crucifiement de Saint-Pierre pour la cathédrale de Paris et joue un rôle actif dans la fondation de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
Son talent est reconnu jusqu’en Suède où la reine Christine l’invite. Il peindra plusieurs portraits d’elle et de personnalités de la cour. Il est considéré comme l’un des peintres majeurs du classicisme français.
Le buisson ardent, 1642-1645

voir l’œuvre « Le buisson ardent »
Pour les enfants
- Que vois-tu et que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- A ton avis, pourquoi est-ce que Moïse met ses mains sur ses yeux ?
- Qui est représenté en face de lui ?
Pour les ados/adultes
- Jeu de « cache-cache ? » Ce n’est pas Dieu qui se cache dans le buisson mais peut-être Moïse qui cherche à se « faire oublier » après avoir tué un Égyptien et s’être constitué une nouvelle vie « tranquille » avec ses troupeaux.
- Buisson : deux étages, un classique, marron, collé à la terre, mais derrière lequel la lumière peut passer au-dessus et vient illuminer, par derrière, notre réalité. Elle est éblouissante, il faut choisir de la recevoir.
- Qu’est-ce que la représentation de Dieu induit ? (homme blanc, âgé, barbu)
- Question de la signification des anges (forment une sorte de trinité) et de celle des deux taches de couleur (bleu, rouge).
- Composition en deux triangles inversés avec comme point de convergence la lumière. En bas, composition sobre et très humaine, gamme de couleurs de la terre. En haut, composition baroque, classique, riche avec « Dieu » en majesté, accueillant comme un père, mais aussi très en surplomb.
Exode 3, 1-10
Bourdon a utilisé la composition de la fresque de Raphaël « Moïse devant le buisson ardent », qui se trouve au plafond de la Stanza di Heliodorus au Vatican. Il représente, fidèle au texte biblique, Moïse se cachant les yeux car il craint de voir Dieu.
Le peintre représente Dieu qui souhaite délier son peuple de la servitude. Dieu n’est pas le buisson ardent, ni la voix d’un ange. Il est celui qui s’investit dans cette pâte humaine qu’il a créée. Il n’est pas une divinité assise là-haut, aveugle, sourde et indifférente. Il est le Dieu qui descend pour son peuple, le Dieu qui s’abaisse pour le délier et le conduire.
Le passage de la mer Rouge, Taka Mizukami
« La Bible et l’art contemporain » Méromédia, 2003
Né en 1941 au Japon, Taka Mizukami est un artiste peintre installé en France depuis 1980. Il dit de son art : « La Matière est mon inspiration. Elle peut se présenter sous forme solide ou liquide, brute ou limpide, minérale ou organique, et chacun de ses atomes renferme l’Histoire de l’Univers. Mon travail consiste à composer l’espace, marier l’équilibre et le déséquilibre, réconcilier l’abstrait et le figuratif, fusionner le Yin au Yang… Mais le plus important, c’est de laisser la Matière s’exprimer librement ! Car elle me guide, et je l’écoute. Je ne suis finalement que sa plume, pour écrire la suite de sa propre Histoire. Ainsi la Matière est à la fois la source et le résultat de mes créations. »
Exode 14, 15-31
Pour les enfants :
- Que vois-tu et que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- Où en est-on dans le chemin de Moïse et du peuple hébreu ?
- Il y a dans ce tableau quelque chose qui évoque le monde des Égyptiens : qu’est-ce que c’est ?
- Pourquoi l’artiste a-t-il choisi la couleur rouge ?
- Qu’est-ce que tu vois d’autre dans ce tableau ? A quoi ça te fait penser ? (trace du chemin bien structurée et comme éclairée grâce à la peinture. La feuille d’or comme une « trace » du peuple hébreu. Le « taureau » comme symbole de force et de colère ?)
Commentaire de l’artiste
J’essaie d’exprimer à travers mes peintures l’énergie que je reçois du cosmos, de l’univers. Je suis comme un outil qui transmet cette force cosmique. De culture Bouddhiste, comme tout être vivant sur terre, j’ai conscience d’appartenir à l’univers – avec le souci du respect et de l’amour des autres.
J’ai abordé la Bible à partir d’une version japonaise de l’Ancien Testament. J’ai choisi l’Exode parce que l’Égypte m’intéresse particulièrement – entre autres le thème de la pyramide. Ce thème nouveau pour moi… m’a stimulé et a trouvé une résonance profonde en moi.
La traversée de la mer Rouge, Chagall, 1955
voir l’œuvre « La traversée de la mer Rouge »
Pour les enfants
- Que vois-tu et que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- Cette image te rappelle-t-elle un tableau ? Lequel ?
- Dieu n’est pas représenté, et pourtant, il est bien présent, il entoure le peuple. Comment est-il représenté ?
- Qui sont les personnes peintes en rouge en bas du tableau ?
Après la Shoah, il est important pour Chagall de symboliser toutes les souffrances du peuple juif martyrisé à travers les siècles. Dans ce tableau, le peuple hébreu en rang serré, guidé par un ange, s’engage dans le passage ouvert d’un geste impérieux par Moïse debout sur la gauche. Un grand ange et un juif errant conduisent le peuple loin de la Shoah, figurée à droite, où Jésus crucifié est environné de réfugiés fuyant un village en flammes. Le peuple juif est conduit à gauche vers David en train de jouer de la lyre près de la tour de David à Jérusalem.
La nuée évoquant la présence divine qui accompagne les Hébreux et la vague se refermant sur le pharaon et son armée sont confondus dans une masse blanche au centre du tableau.
Là où la colonne de nuée sépare les Égyptiens des Hébreux, un ange apporte une Torah ouverte pour suggérer la raison de cette scission.
La violence des poursuivants est rendue visible par la couleur rouge et l’agitation des personnages par le désordre de leurs membres en tous sens. La scène figure encore dans Moïse devant le buisson ardent, l’un des tableaux du message biblique.
Moïse est porté par plus grand que lui mais il est aussi dans une position d’autorité, de conduite ; il indique clairement la voie.
Autres éléments à commenter éventuellement dans le tableau : le Christ en croix en haut à droite, le peuple à l’arrière-plan, crucifié en même temps que lui, le Roi David en haut à gauche, le clocher du village de Vitebsk, le poisson, le couple.
« Let my people go » Aaron Douglas (Exode 14)
voir l’œuvre « Let my people go »
Aaron Douglas (1899-1979) est né à Topeka, dans le Kansas, de parents qui ont participé à la Grande Migration, les vagues de populations afro-américaines qui ont fui la discrimination dans le Sud sous les lois Jim Crow. Après avoir obtenu un diplôme d’art à l’université du Nebraska et enseigné à Kansas City, dans le Missouri, Douglas s’est rendu à New York pour s’immerger dans les développements culturels de Harlem dont il avait entendu parler. Il s’est rapidement imposé comme l’un des artistes visuels les plus doués de la Renaissance de Harlem, d’abord en illustrant des revues et des livres, grâce auxquels il a développé son style graphique distinctif synthétisant le design contemporain et les sources égyptiennes anciennes.
Cette peinture fait partie d’une importante série de huit compositions que Douglas a réalisées à partir de dessins plus petits qu’il a créés en 1927 pour un projet de collaboration avec l’auteur James Weldon Johnson, God’s Trombones, l’une des plus grandes réussites littéraires de la Renaissance de Harlem. Illustrant l’histoire biblique de l’ordre donné par Dieu à Moïse de conduire les Israélites hors de la captivité en Égypte, « Let My People Go » est une puissante allégorie de la libération et de l’illumination, qui s’est répercutée au fil du temps au sein des communautés afro-américaines confrontées à la persécution institutionnelle et culturelle.
« Let My People Go » au Metropolitan Museum of Art présente la silhouette caractéristique de Douglas, avec des formes figuratives plates et des contours clairs définis par des passages monochromatiques et des couleurs sobres. Ce style doit beaucoup au regain d’intérêt pour l’art égyptien après le dévoilement de la tombe du roi Toutankhamon (en 1922), ainsi qu’à l’intérêt contemporain pour le design Art déco et l’art africain.
Réalisée dans une palette inhabituelle de lavande et de jaune-or, l’œuvre illustre le récit du livre de l’Exode, dans lequel Dieu ordonne à Moïse de conduire le peuple hébreu hors de la captivité en Égypte. La lumière divine rayonne du coin supérieur gauche de la composition en arcs concentriques jusqu’à la figure agenouillée de Moïse près du coin opposé.
Les trois grandes pyramides de Gizeh apparaissent derrière Moïse, tandis que de petites accumulations de marques verticales suggèrent la masse des Hébreux asservis attendant la liberté. Les régiments du pharaon se rassemblent pour la bataille le long du côté gauche, rempli de vagues stylisées, qui peuvent faire allusion à la séparation de la mer Rouge par Moïse.
Let My People Go illustre l’appropriation par l’artiste de récits historiques en tant qu’allégories de l’expérience et de l’identité afro-américaines. L’histoire de Moïse dans l’Ancien Testament fait écho à l’histoire de l’esclavage dans les communautés afro-américaines.
Pour les enfants
- Que vois-tu ? Que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- À quel moment de l’histoire se trouve-t-on ?
- À ton avis, où est Moïse dans ce tableau et dans quelle position est-il ?
- Qu’est-ce que tu remarques de particulier dans ce tableau pour représenter ce moment de l’histoire (les couleurs, les personnages) ?
Commentaire ados/adultes
- Seul Moïse est éclairé par la lumière divine.
- Position de fragilité : il semble nu, il implore (les Égyptiens sont casqués et armés)
- Sur la question de la transposition à l’époque contemporaine : un Moïse « africain ».
- Violence : les lances, les chevaux, les éclairs.
La danse de Myriam, Chagall, 1966. Exode 15, 20-21
voir l’œuvre « La danse de Myriam »
En 1966, Chagall réalise 24 lithographies colorées sur le thème de l’Exode d’Égypte, marquées par la direction des trois enfants d’Amram, Moïse, Aaron et Myriam. Cette œuvre représente un moment de célébration, où la prophétesse Myriam danse dans le groupe en jouant du tambourin. Les personnages sont typiques de l’imaginaire joyeux et lyrique de Chagall, ainsi que la richesse des couleurs pures.
Pour les enfants
- Que vois-tu ? Que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- A quel moment de l’histoire est-ce qu’on se trouve ?
- Qui est le personnage au centre du tableau ?
- Comment la reconnais-tu ?
- Qu’est-ce qui donne un air joyeux à ce tableau ?
- Est-ce que tu vois des animaux sur ce tableau ? Lesquels ?
- Est-ce que tu vois des instruments de musique ? Lesquels ?
Commentaires ados/adultes :
- Construction de la composition en pyramide pour faire monter la louange // avec les « sacrifices de bonne odeur » : de la même manière qu’on fait monter la fumée, on fait monter la louange par la danse.
- Toutes les femmes ont les bras levés.
- Tableau en courbes (féminité) et en mouvement.
La danse, Chagall, 1950-52
voir l’œuvre « La danse »
La culture hassidique et biblique dont Chagall est imprégné assimile la danse à une prière ou à une action de grâce. Le peuple d’Israël danse pour louer Dieu après une victoire, pour exprimer la joie et la reconnaissance pour la grâce donnée.
Dans le livre de l’Exode, après le passage de la mer Rouge et le chant de Moïse, Myriam la prophétesse, sœur d’Aaron, prend son tambourin et entraîne toutes les femmes derrière elle à chanter pour le Seigneur. Il s’agit de mettre tout son corps en mouvement pour louer Dieu. On peut reconnaître Myriam en bas, au premier plan, avec d’autres femmes qui font la ronde dans cet autre tableau de Chagall qui évoque la danse en général. Derrière Myriam, c’est le village de Vence reconnaissable à la circularité de son enceinte et à son clocher. Le paysage est méditerranéen ; sur la mer, proche, une voile se profile.
Le veau d’or, Pierre Assemat
« Bible et œuvre d’art en regard » parcours pour une catéchèse en image, Méromédia, 2005
Né en 1940 dans le Tarn, P. Assémat « est entré en peinture, comme on entre en religion, c’est-à-dire pour vivre totalement sa foi en cet art qui existe depuis l’homme des cavernes, depuis le jour où celui-ci a trempé sa main dans l’argile pour l’opposer sur la paroi du rocher et créer ainsi le premier geste plastique ».
Exode 32, 1-14
Composition
La toile est divisée en trois registres superposés : En bas, la foule bigarrée composée d’hommes et de femmes aux regards dirigés vers le haut et aux doigts pointés vers le veau d’or.
Au milieu, trois téléviseurs posés sur des étagères et allumés. Ils présentent des scènes sportives, cyclisme, foot et tennis, les sports les plus populaires, ceux qui sont au centre des échanges d’argent les plus importants. Au-dessus, surplombant la scène, le veau d’or. Il est seul et auréolé́ d’or sur un fond bleu.
Interprétation
Une manière cynique de mettre en image l’adage « Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus » mais aussi une façon caricaturale de représenter la marche du monde. A l’enfer de la vie quotidienne où tout le monde se bat, se marche dessus pour obtenir le ballon ovale c’est-à-dire être le gagnant, le point de mire de tous les autres, succèderait le purgatoire des médias. A demi sauvé du monde et de son anonymat, la star du sport devient l’exemple à suivre et à fêter pour atteindre enfin, encore au-dessus, la renommée, la fortune et la gloire matérielle que figure le veau d’or.
La violence dénonciatrice du propos du peintre est soutenue par le jeu des couleurs, celui des complémentaires bleu/oranger, vert/jaune, ainsi que par la caricature satirique de son dessin. Dans l’arène du monde déterminée par les étagères qui soutiennent les téléviseurs, des formes humaines presque indistinctes ne surnagent que quelques expressions typées comme les dents de requin du rugbyman ou les visages renversés et extatiques de quelques femmes. Une humanité déchue, livrée à l’envie et à la rage de participer aux jeux du cirque et de partager une victoire dont elle n’aura été que spectatrice. En revanche, les télévisions présentent sans trêve les images des épisodes clés des sports évoqués provoquant holà et cris festifs : c’est l’arrivée au col, le tir au but ou les services mortels ! Au-dessus placide et seul, brille de mille feux le veau tout d’or revêtu, unique espoir et religion de cette foule en délire.
Conclusion
Tous les moyens mis en œuvre par l’artiste pour nous donner sa lecture vivante et actualisée du texte biblique contribuent à nous faire réfléchir sur nos valeurs : la réussite individuelle au mépris des autres ? La gloire frelatée par la drogue ? L’argent comme valeur suprême ?
Pour les enfants
- Que vois-tu ? Que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- Quels sont les sports représentés ?
- Regarde les visages : quelles expressions vois-tu sur ces visages ?
- Un animal doré placé au-dessus des écrans : qu’est-ce que l’artiste a pu vouloir dire ?
- A quelle étape du parcours est-ce qu’on est ?
Ados/adultes
- Qu’est-ce qui caractérise une idole, comment la définir ?
- Même type de questions. Susciter et élargir le débat : quelles sont nos idoles aujourd’hui ?
- A relier à la question des addictions (qui n’est pas absente du texte biblique, puisque le peuple ne peut se passer de « posséder « un » Dieu) ; désir/possession…
Le veau d’or, Chagall, 1965-66
Commentaire
Cris, danse, manifestations de joie au service du veau d’or.
Raideur des personnages dans la partie haute, les couleurs nous indiquent que la scène reste très humaine et peu joyeuse (prédominance de la couleur « terre »), en bas, attitudes de soumission.
Pour les enfants
- Que vois-tu ? Que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- A quelle étape correspond ce tableau ?
- Qu’est-ce qui est au centre du tableau ?
- Dans quelles positions sont les gens autour du veau ?
- Que font-ils ?
- Qu’est-ce que tu ressens en regardant ce tableau ?
Ados/adultes
- Qu’est-ce qui caractérise une idole, comment la définir ?
- Même type de questions. Susciter et élargir le débat : quelles sont nos idoles aujourd’hui ?
- A relier à la question des addictions (qui n’est pas absente du texte biblique, puisque le peuple ne peut se passer de « posséder « un » Dieu) ; désir/possession…
Pour aller plus loin : autre référence proposée, celle du veau d’or de Damien Hirst (artiste britannique)
Cette installation de 10 tonnes s’est vendue 140 millions d’euros en 2008. L’animal est installé dans un aquarium de formol avec les sabots, les cornes et un disque posé sur son crâne, en or 18 carats.
Moïse recevant les tables de la loi, 1960-1966, Exode 34, 1-9
Chagall représente un moment fondateur dans l’histoire du peuple juif, qui scelle l’alliance de celui-ci avec Dieu. L’importance de l’événement est traduite par la lumière intense qui baigne la toile. Deux diagonales se croisent.
Une diagonale marque le lien entre Moïse et Dieu. Chagall ne représente pas Dieu, il peint les mains de Dieu sortant des nuages gris. Dieu donne les tables de la loi à Moïse, dont le corps est tendu vers le ciel. Les pieds du patriarche reposent sur le roc mais il est en même temps presque porté par le peuple. Une partie du peuple l’attend en bas, au pied du mont Sinaï, les visages tournés vers lui.
Une autre partie du peuple, en haut sur la gauche, adore le veau d’or au somment de l’autre diagonale qui est celle de la montagne qui rejoint le ciel. Au pied de celle-ci, on retrouve des personnages marquants de l’histoire du peuple juif : Aaron le frère de Moïse tient une menorah. Sur sa poitrine, un pectoral à 12 cases brodées de pierres précieuses qui figurent les 12 tribus d’Israël. Au-dessus d’Aaron, un prophète méditatif (Jérémie ?), le roi David sur son trône et, tout en haut, proche de Dieu parce qu’il se met sous sa protection, un groupe de juifs en fuite.
En plus des aspects bibliques, des éléments plus personnels de la vie de l’artiste sont représentés dans ce tableau : l’ange à la Torah, les toits de Vitebsk, et la famille de l’artiste en quelques traits allusifs.
Pour les enfants
- Que vois-tu ? Que comprends-tu ?
- Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ce tableau ?
- Trouve dans ce tableau des dessins que tu as déjà vus.
- Qui reconnais-tu au centre du tableau ?
- Qu’est-ce qu’il reçoit ?
- Qui lui donne ?
Ados/adultes
- Qu’est-ce que cette « loi » donnée par Dieu ?
- Quelle est la finalité de la Loi ?
- Quelle actualité pour aujourd’hui ?
- La loi est tantôt appelée « enseignement », « commandement », « paroles », comment recevez-vous ces différentes appellations ?
Crédit : Brigitte Reymond et Laurence Flachon



 En 2024, les paroisses de l’UEPAL élisent les membres du Conseil presbytéral et en mai 2024, un.e président.e de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine sera élue.
En 2024, les paroisses de l’UEPAL élisent les membres du Conseil presbytéral et en mai 2024, un.e président.e de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine sera élue.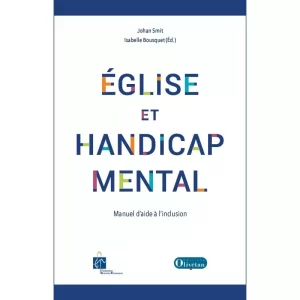 Johan Smit et Isabelle Bousquet sont les auteurs du livret « Eglise et handicap mental », véritable manuel d’aide à l’inclusion. Sorti presque inaperçu des presses pendant la période du confinement, nous voulons aujourd’hui saluer ce manuel si riche en propositions concrètes.
Johan Smit et Isabelle Bousquet sont les auteurs du livret « Eglise et handicap mental », véritable manuel d’aide à l’inclusion. Sorti presque inaperçu des presses pendant la période du confinement, nous voulons aujourd’hui saluer ce manuel si riche en propositions concrètes.
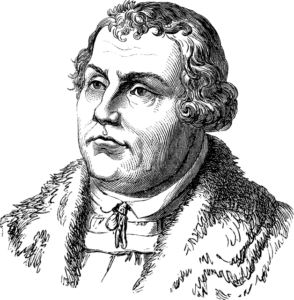 L’origine de la Réforme, qui a donné naissance au protestantisme est une épopée qui a débutée à Wittemberg (Allemagne) en 1517. Luther placarde 95 thèses sur la porte de l’Eglise, en réponse à la vente des indulgences. Par cette chanson catéchétique,
L’origine de la Réforme, qui a donné naissance au protestantisme est une épopée qui a débutée à Wittemberg (Allemagne) en 1517. Luther placarde 95 thèses sur la porte de l’Eglise, en réponse à la vente des indulgences. Par cette chanson catéchétique,